Sera-ce l’ultime avatar d’Orphée, l’énième dépècement de l’écorché vif, le dernier cri en la matière ?
Dans la nuit des temps, et selon le mythe, Orphée, prince des sons, musicien thaumaturge, bouleversait l’ordre du monde, le monde des hommes, des Dieux, de la nature et des bêtes. Orphée, déclinant ensemble la poésie et le chant apprivoisait les animaux sauvages, arrêtait le cours des fleuves ou apaisait le vent. La récompense d’un pareil talent ne se fit pas attendre (un bienfait ne doit jamais rester impuni) : Orphée pour prix de la séduction que son art exerçait, connut la mort d’un supplicié ‒ son corps déchiré par les Ménades ‒ dont seule la voix, chant immortel, réchappa.
Démis pour avoir ému, Orphée paie littéralement de sa personne. Son corps défait pour avoir fait de l’effet. Les Dieux antiques n’accordent à la musique d’être céleste que délestée de la chair décidément trop leste.
La musique de toute éternité fait se joindre bruissement de l’impur et silence idéal, retenues et ébats. Aux confins indécelables du verbe et de la chair, le son fait sens par le trop plein des sens et la pensée qui s’abandonne. Impensable à proprement parler, cet endroit de nous qui à la fois jouit et s’abstient. Cette indécise indécence orphique, n’eut pas l’heur de plaire aux Dieux. Elle heurte aussi les hommes, écartelés au corps à corps entre Janus et Jansénius .
Ce que les évêques du Concile de Trente, qui décréta l’évincement pour toute musique liturgique du lascif et de l’impur (lascivium aut impurum), n’avaient osé espérer : arrêter le balancier mystérieux de la musique, la décharner, (à propos de charnel, on connaît l’adjectif qui, pour Pierre Boulez, qualifiait les musiques les plus ignominieuses : elles étaient « épidermiques »), ce que le Concile n’avait osé, ce siècle le réussit grâce à quelques hommes qui, embrigadant malgré elle la pensée d’Adorno, établirent en musique une manière de puritanisme grimé sous des oripeaux avant-gardistes.
Orphée n’avait qu’à bien se tenir.
Il s’agira alors de le traquer comme une Bête menaçant la Belle, d’avoir sa peau, d’élaborer un langage enfin pur qui éradiquerait sa voix, son cri.
Arme maîtresse pour évincer le corps physique (au profit du corps typographique) : l’esprit de système. Que tout soit en musique démontable et justifiable. Certaines séances d’analyse musicale qui ravissent parfois la place du concert ressemblent à s’y méprendre aux spectaculaires leçons d’anatomie du dix-septième siècle où l’on mettait somptueusement en scène la dissection des corps devant un public ébaubi par l’exactitude du travail. La partition sacralisée par le rituel méthodique de son établissement devint le talon aiguille d’un fétichisme musical confondant la partie pour le tout. L’apothéose du langage unique remplaça le grouillement des langues sonores vernaculaires.
Il fallait avoir le dernier mot, savoir le fin mot de l’histoire de la musique afin, pour en avoir le cœur net, qu’elle rende définitivement l’âme. Le corps, le cœur ou l’âme n’étaient plus que les gris-gris d’un monde disqualifié, réfuté, risible et révolu.
Il fallait qu’Orphée l’enchanteur déchante.
Cette attitude fit sensation en censurant la sensation.
Pavillons bas, messieurs les musiciens, fermez vos écoutilles et circulez : il n’y a plus rien à entendre.
Instrumentalisé, l’instrumentiste dévitalisé dut se soumettre ou se démettre.
Orphée fit le gros dos. À son corps défendant, se laissa décharner une fois de plus. Fin stratège, il leur laissa sa peau comme muent les reptiles. À fleur de sa seconde peau, la musique peut à nouveau s’ajuster à l’entre-deux, entre le son et le signe, entre le corps arraisonné et la raison incorporée dans l’étrange frôlement de maîtrise et d’abandon qui n’isole ni la danse ni la transe de la transcendance.
Le derme encore fragile du fait du récent traumatisme, Orphée, en ce nouveau millénaire, arpente les terres musicales à la recherche du grain de son enfoui, à la recherche du centre du son d’où découlent et où convergent d’infinies panoplies émotionnelles, de précieuses pharmacopées sonores, de touchantes collections de timbres : des musiques qui mordent à l’âme-son.
Orphée, revenu au vivant ‒ sans la vie, la musique serait une erreur ‒, ne se retourne pas ; Eurydice est devant, il le sent, il le sait.
Jean-Paul Dessy
Paru dans « Sons en Mutation », La lettre Volée, Bruxelles, 2003


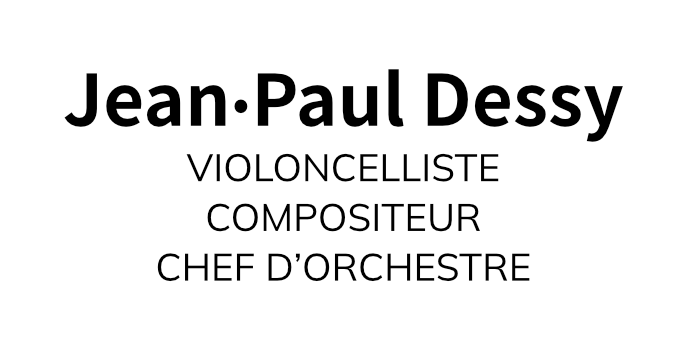


 02/11/2024 19:00
02/11/2024 19:00 08/11/2024 20:00
08/11/2024 20:00